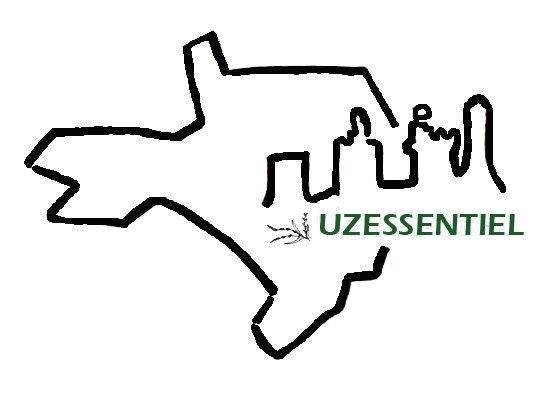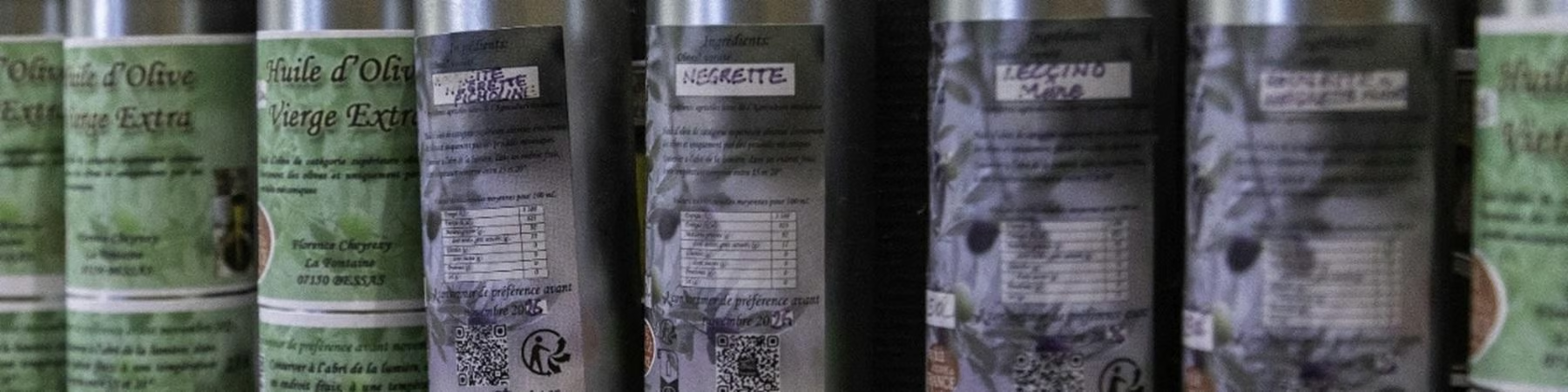Le programme du Ciné club de l'Uzège jusqu'à janvier 2026
La programmation du Ciné club de l’Uzège propose un nouveau thème pour ses prochaines séances, le Cinéma et l’Apocalypse.
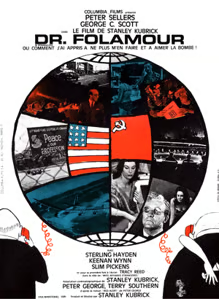 Après la projection du Le septième sceau, d’Ingmar Bergman (1957), lundi 29 septembre, voici Dr. Folamour de Stanley Kubrick, undi 13 octobre à 19 h 45.
Après la projection du Le septième sceau, d’Ingmar Bergman (1957), lundi 29 septembre, voici Dr. Folamour de Stanley Kubrick, undi 13 octobre à 19 h 45.
Dr. Folamour, Film en noir et blanc avec prédominance du noir ! Tu parles, bien sûr, le blanc, on ne le voit pas trop ! Résumer ce film est assez simple : « Arrêtez de faire les cons, sinon voilà ce qui va se passer ! » : premier message. Le deuxième message nous est délivré dans un chuchotement prudent : « Arrêtez de confier votre avenir à des débiles irresponsables, prenez-vous en charge ! » Bien sûr, on peut tout reprocher à Stanley Kubrick, son pessimisme, son cynisme, sa vision caustique d’une humanité engluée dans ses contradictions, son perfectionnisme au-delà du raisonnable. D’accord ! Mais si l’actualité n’a de cesse que de donner raison à ses sombres prédictions, si tel Cassandre, son message ne peut être reçu sans qu’il soit aussitôt accusé de recouvrir l’horizon de nuages noirs, si nous continuons de maudire les effets dont nous chérissons les causes, peut-on pour autant lui en tenir grief ? Revenons au film ! La méticulosité de Kubrick, la performance extraordinaire de Peter Sellers sont ce qui saute aux yeux, de prime abord.
Regardez le film en Dvd et arrêtez l’image de façon aléatoire : chaque fois, merveille de composition, de cadrage et de lumière ; personne depuis Orson Welles n’était parvenu à un tel résultat ! Parlons du contexte : nous sommes en pleine ‘’guerre froide’’, terme convenu. Rappelons qu’en 1962, les Etats-Unis et l’URSS sont au bord de l’affrontement nucléaire, suite à la crise cubaine (mais nous n’avons pas la place de nous étendre sur le sujet). Kubrick, qui affectionne les satires acerbes, met en scène nos dirigeants irresponsables conduisant des politiques absurdes (voir ‘’Les Sentiers de la Gloire’’). Son tour de force est de faire de cette dénonciation un film à l’humour irrésistible, et Stanley Kubrick montre une fois de plus l’immense respect qu’il a pour ses spectateurs : si vous voulez rire, voici de quoi rire ; si vous voulez réfléchir, voici de qui réfléchir. Se rappeler que les peuples aiment Kubrick et que les puissants de ce monde le détestent, cela n’est pas sans signification…
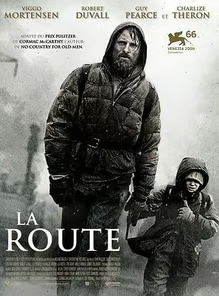 La route, de John Hillcoat (2009), lundi 10 novembre à 19 h 45 : Film dramatique américain réalisé par John Hillcoat, Il décrit une situation post-cataclysmique pour s’ouvrir à la dimension apocalyptique Il est tiré du roman du même nom écrit par Cormac McCarthy. Il s'agit de la troisième adaptation au cinéma d'une œuvre de Cormac McCarthy, après De si jolis chevaux de Billy Bob Thornton et No Country for Old Men des frères Coen. Le réalisateur John Hillcoat et le scénariste Joe Penhall ont mis plus d’un an pour réaliser l'adaptation du livre.
La route, de John Hillcoat (2009), lundi 10 novembre à 19 h 45 : Film dramatique américain réalisé par John Hillcoat, Il décrit une situation post-cataclysmique pour s’ouvrir à la dimension apocalyptique Il est tiré du roman du même nom écrit par Cormac McCarthy. Il s'agit de la troisième adaptation au cinéma d'une œuvre de Cormac McCarthy, après De si jolis chevaux de Billy Bob Thornton et No Country for Old Men des frères Coen. Le réalisateur John Hillcoat et le scénariste Joe Penhall ont mis plus d’un an pour réaliser l'adaptation du livre.
A propos du livre de Cormac McCarthy : Depuis sa parution en 2006 (janvier 2008 pour la traduction française), et l’obtention du Prix Pulitzer en 2007, La Route provoque un engouement mondial mérité. L’écrivain américain y décrit un monde déchu avec un minimum d’effets, dans un style sec et austère, aussi dépouillé que les paysages de cendres dans lesquels évoluent ses rares personnages. Il s’intéresse surtout à la relation poignante entre un homme et son fils ; à la volonté inébranlable et magnifique du premier de protéger le second et de lui épargner le pire, mais aussi de lui transmettre quelque chose du monde d’antan : une morale, une ligne de conduite. Le vrai sujet du roman, au-delà de l’anecdote post-apocalyptique, c’est la formation d’un être humain qui soit à la fois héritier d’une civilisation mourante et espoir d’un hypothétique renouveau.
La Route suit la vie d’un père et de son fils qui évoluent dans un monde post-cataclysmique. Le roman ne précise jamais leur nom, les identifiant simplement comme « le père » et « l’enfant » ou « le garçon ». Le duo voyage vers le sud, sur une route ponctuée de cendres et d’épaves, dans l’espoir d’y trouver un climat plus chaud et une vie meilleure. La fin du livre nous invite à voir la survie non pas comme un ensemble d’actes physiques, mais comme la façon dont nous préservons notre humanité dans des situations d’extrême dévastation. Elle pose une hypothèse sur la persistance de la bonté humaine même face à une fin imminente. C’est un démenti brutal de l’idée selon laquelle toutes les structures éthiques s’effondrent lorsque la survie est en jeu. Quand tout parait perdu, l’enfant semble porter tous les espoirs.
 L’armée des douze singes, de Terry Gillian (1995), lundi 28 décembre à 19 h 45. Inspiré par La Jetée de Chris Marker (1962) « L’Armée des 12 singes est un film d’art européen au sein du système hollywoodien. » Terry Gilliam, cité par le British Film Institute (BFI) à propos de la genèse du film.
L’armée des douze singes, de Terry Gillian (1995), lundi 28 décembre à 19 h 45. Inspiré par La Jetée de Chris Marker (1962) « L’Armée des 12 singes est un film d’art européen au sein du système hollywoodien. » Terry Gilliam, cité par le British Film Institute (BFI) à propos de la genèse du film.
En 2035, un virus a décimé l’humanité, poussant les survivants à vivre sous terre sous le contrôle d’une organisation scientifique. Pour retrouver l’origine de la catastrophe, des prisonniers sont envoyés dans le passé. James Cole (Bruce Willis) est chargé de cette mission, mais ses voyages temporels imprécis le projettent entre différentes époques. Interné dans un hôpital psychiatrique, il rencontre la docteure Kathryn Railly (Madeleine Stowe) et Jeffrey Goines (Brad Pitt), militant exalté. Obsédé par l’« Armée des 12 singes » qu’il croit responsable du virus, Cole se retrouve pris dans une boucle temporelle où se dessine un destin déjà écrit.
Terry Gilliam signe avec L’Armée des 12 singes un film paranoïaque, teinté de mélancolie. Ce film explore ainsi la mémoire, le temps et la folie comme une possible lucidité. Mais il va plus loin : le film boucle une véritable spirale cinéphilique. Il s’inscrit dans une filiation directe avec Chris Marker (La Jetée), lui-même héritier d’Hitchcock (Vertigo), deux cinéastes qui ont placé la question de l’image obsédante et de la boucle temporelle au cœur de leur art. Gilliam reprend cette spirale et y inscrit son propre cinéma, au point de transformer ce film de commande en une œuvre d’auteur. Un film qui pense le cinéma, et qui invite le spectateur à en faire autant.
L’Armée des 12 singes est aussi un film ambigu, qui joue avec la figure de la star hollywoodienne tout en la détournant. Bruce Willis, habituellement associé aux rôles de héros d’action invincibles, apparaît ici vulnérable, perdu, hanté par des visions qu’il ne comprend pas. Brad Pitt, de son côté, délaisse l’image de playboy séduisant pour incarner un personnage borderline, hystérique et imprévisible, qui révèle une puissance d’interprétation insoupçonnée. Madeleine Stowe, enfin, offre une présence essentielle, en faisant basculer son personnage de témoin rationnel vers une figure habitée par le doute et l’inquiétude. Gilliam donne ainsi à ces stars l’occasion de prouver leur valeur actoriale en les montrant sous un jour inattendu, loin des codes hollywoodiens qui les avaient consacrés. Plus qu’un film de science-fiction, L’Armée des 12 singes est une expérience troublante qui interroge notre rapport au temps et au monde : une invitation à penser, mais aussi à rêver autrement : « You’ve got to work at maintaining your version of the world. So start being alone. »
Les fils de l’homme, d’Alfonso Cuaron (2006), adapté du roman de P.D. James, « Children of Men », lundi 12 janvier 2026 à 19 h 45.
Le ciné-club est heureux de présenter Alfonso Cuaron à ceux qui ne le connaissent pas. Alfonso Cuaron n’a pas perdu son temps à regarder des films sans intérêt ! Ses modèles ? Tarkovski (Stalker), Murnau (Sunrise), Kubrick (Orange mécanique). Il fallait aller chercher très haut pour faire ce chef d’œuvre de la S.F., considéré déjà comme un des plus importants de ce début de 21e siècle. Disons tout de suite que nous sommes à l’opposé de Blade Runner, de Dune et autres classiques de la S.F. Children of Men (titre à consonance biblique) est un thriller dystopique presque unique, dont toutes les images semblent tirées de reportages d’actualités. Dans un climat de terrorisme, de répression, de pandémie et de racisme, l’humanité est devenue stérile. Un homme se voit confier une mission dont il ne connaît pas les aboutissements : sauver une vie ! Qu’importe de la sauver, pensera-t-on, dans un monde qui meurt ? Seulement, voilà, cette vie est porteuse d’une vie, et pour sauver cette vie qui vient, il sacrifiera la sienne ! Voilà pour l’histoire. On retrouve deux idées portées par notre thématique : un héros qui se sacrifie, qui donne sa vie pour ceux qu’il aime ; et l’enfant qui vient : ultime espoir, dernière chance, porteur de toutes les espérances !
Cela commence sur une sidérante scène d’attentat tournée à Londres, caméra à l’épaule comme un reportage de la BBC, sur Fleet Street, sur les lieux même où un attentat à la bombe eut lieu en 2005, quelques mois avant le tournage. Cuaron annonce la couleur : attention, ne commettez pas l’erreur de croire que je vais parler de choses qui n’ont jamais eu lieu, sorties de mon imagination, ou qui n’auront jamais lieu !
L’extinction de l’humanité n’est plus une menace ou un risque, elle a commencé ! Londres ressemble à Beyrouth, ses quartiers périphériques aux bidonvilles de Syrie, du Brésil ou de Manille. Aucune fiction dans ce film, juste quelques transpositions, quelques décalages : et, aussitôt, la réalité prend une tout autre couleur. Une sorte de fable, en somme ! La scène du cessez-le-feu, fantastique long plan-séquence, presque surnaturelle, interrompant quelques instants qui semblent durer une éternité le massacre, où tous les protagonistes, sidérés, contemplent cette vie neuve venant mettre un terme à la stérilité de l’espèce humaine n’est pas qu’un exploit technique de scénographie et de lumière (Lubezki, quel artiste !). C’est un MOMENT de cinéma inoubliable ! Chargé d’émotion, de sens, plein d’espérance, tourné à la perfection, l’immersion est totale. Cuaron renoue avec l’ancienne « esthétique de l’immersion », que la moderne « esthétique de la distraction » n’a jamais, heureusement, fait disparaître.
Alors, ce film : Vision sombre d’un avenir trop lourd de menaces ? Cri d’alerte pour réveiller les consciences endormies ? Fable distrayante, trop noire pour être crédible ? Réalité à peine transposée d’un monde devenu effrayant ? Alfonso Cuaron ne conclue pas. A vous d’imaginer une suite et peut-être une fin. Comme tous les grands réalisateurs, il ne vient pas nous donner une leçon de morale, mais seulement nous offrir un grand film, que vous n’oublierez pas de sitôt !...
Le Cinéma et l’Apocalypse selon Daniel Frison
« Depuis longtemps l'être humain a essayé de concevoir ce que serait une fin de son univers. Tous les textes qui ont été écrits sur ce futur hypothétique et incertain bien avant l'apparition du cinéma s'appuient sur des images mentales. Les textes de la Bible eux-mêmes sont composés d'images symboliques (les quatre cavaliers, l'agneau immolé...). Disons tout de suite que dans la Bible, l'Apocalypse est une bonne nouvelle pour les croyants. Elle annonce des cieux nouveaux et une Terre nouvelle.
En 1906 Après le tremblement de terre de San Francisco, le film de la Biograph Company, évoque déjà une catastrophe apocalyptique. Depuis, le cinéma n'a cessé de projeter des images de catastrophes, de cristalliser sur grand écran les craintes suscitées aussi bien par le devenir collectif de l'humanité que par le sens de l'existence individuelle.
Cette thématique apocalyptique est bien sûr présente dans le cinéma hollywoodien à grand spectacle qui a beaucoup développé un cinéma de l'inéluctable, basé sur l'attente ou sur la promesse, sur l'imminence d'un danger par exemple. Mais elle a également été développée dans des films plus personnels.
Ces images filmiques ne sont plus seulement des métaphores littéraires fantasmées par le spectateur mais elles sont visibles sur l'écran, concrètes, même si elles représentent des catastrophes, des désastres, la fin du Monde, ou la fin d'un monde. Elles prennent les formes les plus diverses alimentant une création foisonnante où les allusions aux textes bibliques côtoient les références à des périls réels ou fantasmés : des épidémies, des cataclysmes naturels, tornades, éruptions, incendies, mais aussi des causes cosmiques, chutes de corps célestes, accidents solaires...
Ces films ont pour fonction de frapper le spectateur par leur puissance visuelle, surtout lorsqu'ils nous font revivre des conflits mondiaux, des catastrophes nucléaires, des dictatures... Ces traumatismes sont souvent associés à la notion de destruction aveugle : surgit tout à coup une force catastrophique qui produit une rupture avec le cours normal de l'histoire. Ils deviennent incompréhensibles, illogiques, et même inexplicables.
Heureusement le film apocalyptique permet toujours au spectateur de suspendre son adhésion complète, de garder une certaine incrédulité durant l'espace du film lui-même. Cela repose sur la façon dont la narration est conduite : le choix et la composition des images, les mouvements de caméra, les angles de prises de vue... et bien sûr la bande son, les bruits, les voix et la musique. Ce qui est en jeu c'est ce que doivent ressentir les spectateurs volontairement captifs dans la salle obscure. Alors l'image peut être saturée allant jusqu'à donner l'impression qu'elle est à l'étroit dans le cadre, comme si la foule filmée allait envahir la salle. Le spectateur est bombardé de sensations, la saturation de l'image s'accompagne d'une saturation des sens sonores ou visuels. Ou alors, à l'opposé, le spectateur est parfois amené à errer dans des lieux vides, désolés, avec des couleurs désaturées, une bande son à peine audible. Le rythme est même ralenti : engourdi, le spectateur est menacé d'immobilité. Ce qui lui donne l'envie d'emplir, d'envahir ce cadre, de s'impliquer totalement. Il est amené à scruter et donc interpréter la moindre manifestation du visible et du sonore.
Au cinéma, ces événements ont lieu ici et maintenant, pour un public captif - mais conscient et volontaire. Les conditions de réception de ces films à tendance apocalyptique sont particulières. Projetés dans l'obscurité de grandes salles, simultanément aux quatre coins de la planète, le spectateur ne peut ni les contrôler ni les arrêter. La puissance du récit s'ajoute à la sidération des images représentant des scènes dignes des films d'horreur qui s'appuient parfois sur des tableaux apocalyptiques, comme Les panneaux de l'enfer de Jérôme Bosch ou La chute des anges rebelles de Pieter Bruegel, deux tableaux qui représentent ou préfigurent les horreurs de l'apocalypse en illustrant des scènes infernales où fourmillent des personnages hybrides imaginaires.
Au cinéma, l'apocalypse a lieu dans le présent de la projection, même si elle se présente comme une menace à venir ou à l'inverse comme une expérience terrifiante passée dont il faut tirer des leçons. Le récit est soit une prédiction soit une vision. Si la catastrophe a déjà eu lieu, il ne reste que des ruines dans un monde dévasté. Le spectateur est dans l'après-coup du cataclysme. Le survivant devient alors un témoin. Parfois il figure à côté du combattant qui a vécu la catastrophe (La route, John Hillcoat, 2009))
L'idée d'apocalypse n'est heureusement pas toujours associée à la fin du monde au sens collectif, de la disparition de l'humanité. Il serait plus juste de la rapprocher de la fin d'un monde : elle impliquerait alors la genèse de quelque chose de nouveau pour les individus, un espace-temps autre qui pourrait être un autre espace-temps.
Une apocalypse personnelle relève plutôt de la fin d'un monde individuel d'être au monde. Les événements traumatiques déclencheurs peuvent être un changement d'ordre professionnel, d'ordre familial... L'étymologie d’apocalypse renvoie à « un dévoilement ou à une révélation ». La fin d'un espace intérieur serait toujours suivie d'un renouveau. L'apocalypse deviendrait une expérience presque mystique pour chacun d'entre nous. Dans ces films, une nouvelle vie est possible après la catastrophe. A l'occasion d'un événement apocalyptique, les individus ou les responsables de la société œuvrent pour faire régner les valeurs telles que le courage, l'abnégation, l'amour, la fraternité, allant jusqu’au sacrifice pour la survie des autres.
Dans le cas de représentations d'apocalypse écologique, le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources naturelles, l'empoisonnement en marche de la planète par exemple, il s'agit en quelque sorte de prévenir le traumatisme afin que nous agissions de manière adéquate. Il s'agit de provoquer une certaine prise de conscience. Le public est averti d'enjeux concrets susceptibles de conduire à une catastrophe à laquelle il faut au pire se préparer, au mieux l'éviter en faisant ce qui est encore possible.
Les films éco-apocalyptiques font reposer la possibilité de la fin du monde sur des motifs environnementaux. Notre humanité est devenue une force capable de changer la face de la Terre. Nous avons un sentiment de toute puissance et nous pensons dominer et posséder la nature. L'homme, l'humanité, contemple comme de l'extérieur une Terre que l'on peut modifier à volonté. Cette attitude aboutirait à la disparition programmée de la nature "naturelle" au profit de la seule expression de l'humanité.
Pour beaucoup, l'apocalypse finale est déjà là, elle est en route. Le discours la concernant est ancré sur le vécu, le réel. Nous savons ce qui nous arrive mais nous n'arrivons pas ou ne voulons pas en tirer les conséquences théoriques et politiques. Ces films évoquant une catastrophe majeure allant même jusqu'à la fin de notre monde sonnent autant comme un avertissement, que comme un appel à une transformation de la société, en présentant cette fin non pas comme une simple hypothèse mais comme un fait à venir incontournable. Tarkowski nous dit que les germes qui précipiteront la fin sont déjà là. Au cinéma la fin du monde n'est pas en général liée à une intervention divine mais procède de la conséquence des actes et des comportements humains.
Dans Docteur Folamour de Stanley Kubrick, l'être humain est en route pour détruire le monde à l'aide d'une bombe atomique. Actuellement c'est notre manière de construire le monde dans lequel nous vivons sans intention destructrice qui engendre sa propre destruction. Nous sommes tous conscients de ces menaces écologiques, nous savons, grâce en partie au cinéma, à quel point la situation est grave mais nous ne changeons pas nos pratiques. Même lorsque la science nous prévient qu'une catastrophe se profile à l'horizon, nous refusons d’accréditer ce sombre présage. Nous ne croyons pas ce que nous savons.
L'apocalypse peut prendre la forme de catastrophes dramatiques mais aussi d'effondrements personnels. Certains réalisateurs mettent en scène des personnages qui se confrontent à leur propre apocalypse personnelle (voir la filmographie de Sam Mendes). Ils se trouvent face à la menace d'un anéantissement mais également face à une possibilité de transformation, ce qui constitue un réconfort pour le spectateur.
Même Armageddon (Michael Bay, 1998) fascine le spectateur par les spectacles de destruction massive et arrive à donner sens et forme à des événements gouvernés par le chaos. Au moins, et c'est ce qui rassure le spectateur, le récit a donné visibilité et compréhension à un événement de nature traumatique. La brutalité de l'événement est malgré tout quand même articulée en un récit intelligible.
Mais lorsque l'événement apocalyptique est tellement inconcevable qu'il met en déroute les modes de représentation habituels, alors le récit ne parvient plus à se boucler sur lui-même et il est même entraîné dans une spirale sans fin (L’armée des douze singes, Terry Gillian 1995).
Heureusement les fictions apocalyptiques ne révèlent pas seulement une catastrophe. Elles nous rassurent sur notre capacité à faire lien, à prendre place dans un vaste ensemble collectif. Comme si à travers ces visions de catastrophes, voire de fin du monde, se développait la sensation ou l'illusion d'une appartenance ou d'une communion. Comme si elle était le signe de notre désir de faire front ensemble.
Et si l'humanité se dévoilait enfin dans son humanité, que la culture moderne a abimée ou en partie recouverte ? Et si l'action pour éviter la catastrophe apocalyptique suffisait à affirmer la nécessité de dépasser l'ancien monde ? Dans plusieurs films, les personnages auxquels les spectateurs peuvent s'identifier survivent ou au pire meurent pour permettre à ce vœu, à cette promesse de se réaliser. »
Vifs remerciements à Daniel Frison et Daniel Mutel pour la documentation transmise et leur collaboration à cet article.